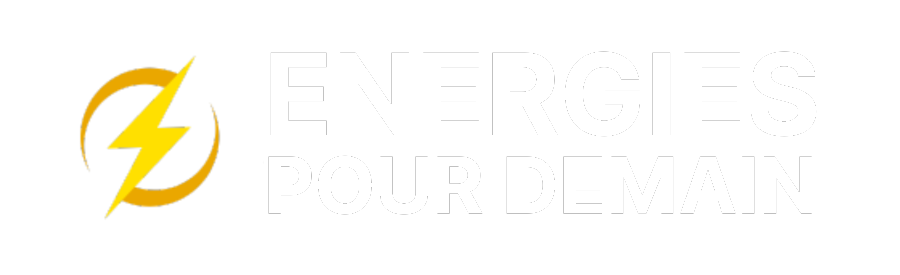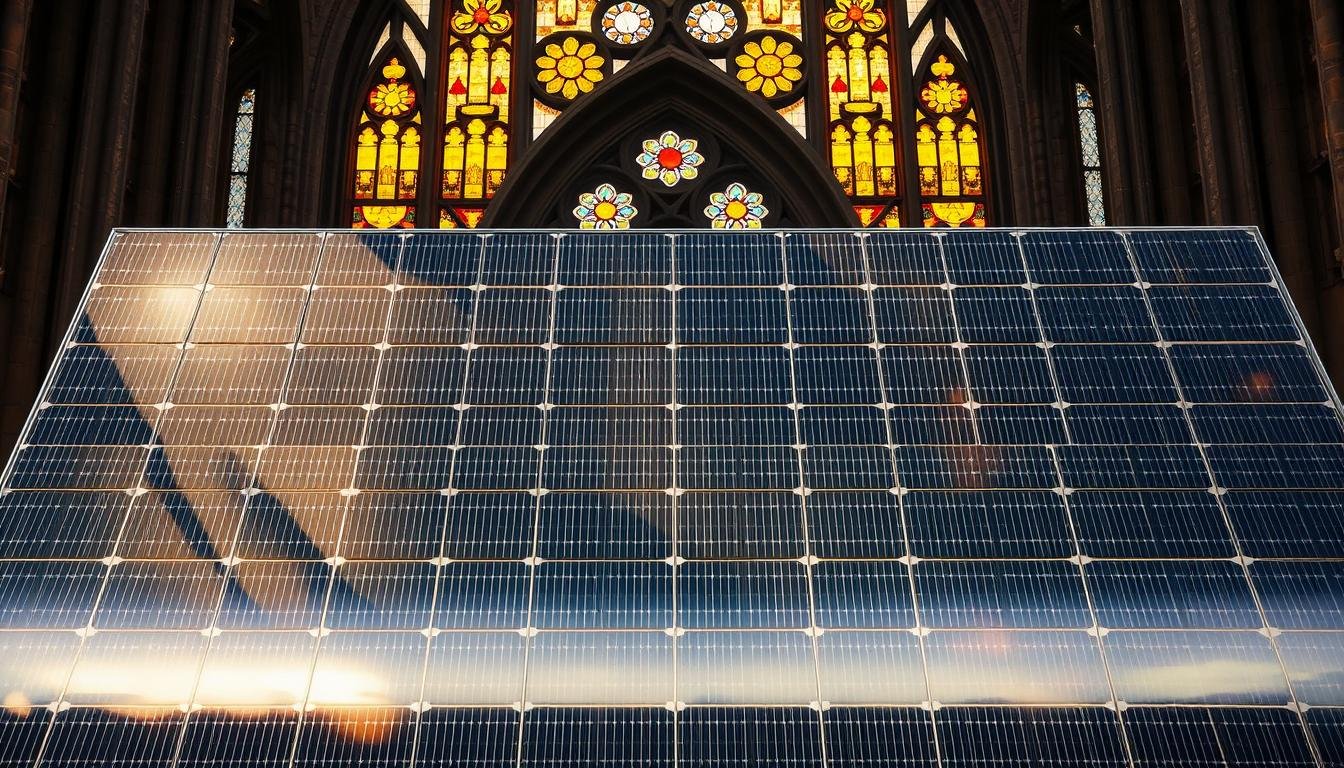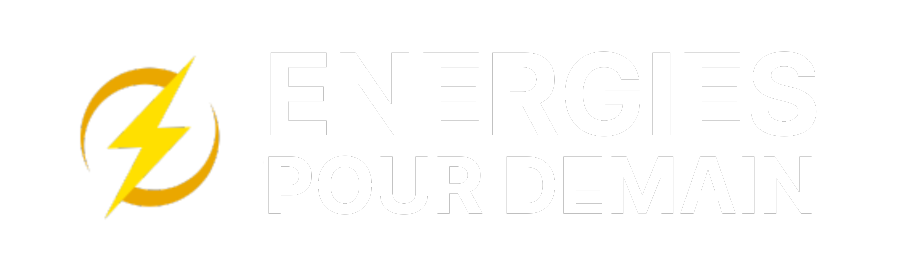Israël marque l’histoire des énergies renouvelables avec un projet ambitieux : une tour solaire dépassant 200 mètres de haut, construite en plein désert. Cette structure, réalisée en béton précontraint, symbolise l’innovation technologique et la transition énergétique mondiale.
Comparée aux projets similaires en Australie (990 m) et en Espagne (750 m), cette construction israélienne se distingue par son intégration dans une stratégie nationale. Elle alimentera près de 200 000 foyers, renforçant ainsi l’autonomie énergétique du pays.
Les zones désertiques, souvent perçues comme hostiles, deviennent des terrains privilégiés pour ces infrastructures. Ce projet s’inscrit dans une perspective historique, depuis le prototype de Manzanares en 1981, et attire l’attention médiatique pour son impact symbolique.
Sommaire
TogglePoints clés à retenir
- Israël construit une tour solaire de 200 mètres dans le désert.
- Comparaison avec des projets en Australie et en Espagne.
- Production d’énergie pour 200 000 foyers.
- Utilisation de béton haute résistance.
- Intégration dans la stratégie nationale énergétique.
Qu’est-ce qu’une tour solaire ? Principe et fonctionnement
Le désert devient une centrale grâce à un principe physique ancestral. L’énergie est produite en exploitant la différence de température entre l’air chaud au sol et l’air frais en altitude. Un cycle thermodynamique naturel se crée, sans émissions polluantes.
Le concept de l’effet de cheminée
L’effet de cheminée est la clé. Les rayons soleil chauffent l’air sous une serre géante. L’air montant dans la tour active des turbines, produisant ainsi de l’électricité. Simple, mais ingénieux.
« Cette technologie utilise des lois physiques basiques pour une production énergétique durable. »
Rôle des collecteurs et des turbines
Les collecteurs (verre ou plastique) captent la chaleur. L’air chaud est dirigé vers la cheminée, où les turbines transforment l’énergie cinétique en électricité. Avantage : même la nuit, le sol emmagasiné restitue la chaleur.
- Stockage thermique : Des conduites d’eau conservent l’énergie pour une production continue.
- Coût compétitif : Moins cher que les panneaux photovoltaïques sur le long terme.
Avantages par rapport aux autres énergies renouvelables
Contrairement à l’éolien ou au photovoltaïque, cette technologie nécessite peu de maintenance. Elle est idéale pour les zones arides, où l’ensoleillement est maximal. Le prototype de Manzanares (50kW) a prouvé sa viabilité dès 1981.
L’histoire méconnue des tours solaires
Derrière chaque grand projet moderne se cache une histoire riche en expérimentations audacieuses. Dès le début du XXe siècle, des chercheurs ont exploré des méthodes pour transformer la chaleur du soleil en énergie. Ces innovations, souvent oubliées, ont pavé la voie aux infrastructures actuelles.

Les pionniers : du Colonel Cabanyes à Jörg Schlaich
En 1903, le Colonel espagnol Isidoro Cabanyes propose le premier concept de cheminée solaire. Son idée ? Utiliser l’effet de convection pour actionner des turbines. Près de 80 ans plus tard, l’ingénieur allemand Jörg Schlaich perfectionne ce principe avec des matériaux modernes.
La tour solaire de Meudon : un instrument scientifique français
La France a marqué l’histoire avec sa tour de Meudon (1964-1967). Haute de 36,47 mètres, elle abritait un spectrographe pour étudier le soleil. Ses miroirs de 80 cm captaient la lumière, permettant des avancées en astrophysique. Aujourd’hui, elle forme des étudiants en master.
« Ce télescope a révolutionné notre compréhension des phénomènes solaires. »
Le prototype de Manzanares (1981-1989)
Ce prototype espagnol, haut de 194 mètres, produisait 50 kW. Malgré son arrêt en 1989 (coûts élevés), il a validé la viabilité technologique. Ses matériaux, du béton armé aux composites, inspirent encore les chercheurs.
- Héritage : Classée monument historique, la tour de Meudon symbolise l’innovation française.
- Évolution : Les miroirs actuels sont 10 fois plus efficaces que ceux des années 1960.
Les projets modernes de tours solaires dans le monde
Trois mégaprojets illustrent aujourd’hui l’évolution des technologies vertes. Chacun combine innovation et puissance, avec des spécificités adaptées à leur environnement. Décryptage de ces réalisations qui repoussent les limites.

La tour israélienne de 200 m : chiffres et ambitions
Avec ses 200 mètres, cette installation alimentera 200 000 foyers. Le béton précontraint utilisé garantit une durabilité exceptionnelle. Un atout clé pour une région soumise à des conditions extrêmes.
Le projet s’inscrit dans une stratégie nationale visant l’autonomie énergétique. Les sociétés locales participent activement à sa réalisation, créant des emplois spécialisés.
Le projet australien de Buronga (990 m)
Plus haute structure du genre, elle culminera à 990 mètres. Sa puissance de 200 MW couvrira les besoins d’une ville moyenne. Le diamètre de la base atteint 7 km, un record.
La construction inclut un système anti-ovalisation pour résister aux vents. Malgré des retards, le calendrier prévoit une mise en service d’ici 2026.
L’initiative espagnole à Fuente el Fresno
Ce projet de 750 m intègre 250 hectares de serres agricoles. Une synergie rare entre production d’énergie et culture maraîchère. La puissance attendue est de 40 MW.
Le coût, estimé à 240M€, est inférieur à celui du modèle australien. Les partenariats industriels, comme avec Schlaich Bergermann, assurent une expertise technique.
- Comparatif technique : L’Australie mise sur la hauteur, l’Espagne sur la polyvalence.
- Défis logistiques : Transport des matériaux en zones arides.
- Innovations : Surveillance incendie et plateformes touristiques.
Technologie et défis des tours solaires
Concevoir des centrales durables exige une maîtrise technique sans précédent. Les projets actuels combinent innovation et résilience, mais soulèvent des questions cruciales : quels matériaux utiliser ? Comment garantir une production rentable ? Quel impact sur l’environnement ?
Matériaux et innovations structurelles
Le choix des matériaux est déterminant. Le béton précontraint (renforcé par des câbles d’acier) domine pour sa résistance aux vents violents. Des composites légers, comme la fibre de carbone, sont testés pour réduire le poids des structures.
Les défis incluent :
- Résister aux variations thermiques extrêmes (de -10°C à 50°C).
- Optimiser l’aérodynamisme pour minimiser les turbulences.
- Assurer une durée de vie de 50+ ans avec une maintenance réduite.
« Les composites offrent une alternative au béton, mais leur coût reste un frein pour les mégaprojets. »
Coûts et rentabilité énergétique
Le kWh produit coûte en moyenne 0,33€, contre 0,05€ pour le charbon. Cependant, l’absence de combustible et la longévité des installations compensent ce désavantage.
Points clés :
- Durée d’amortissement : 12 à 15 ans.
- Subventions gouvernementales couvrant 30% des coûts initiaux.
- Économies réalisées sur 30 ans : jusqu’à 120M€ par site.
Impact environnemental et intégration paysagère
Ces systèmes génèrent une empreinte carbone neutre après 3 ans d’exploitation. Les collecteurs (38,5 km² en Australie) modifient cependant les écosystèmes locaux.
Solutions adoptées :
- Recyclage à 90% des matériaux (verre, béton, plastique).
- Intégration architecturale mimant les dunes désertiques.
- Réduction de l’effet îlot de chaleur via des serres végétalisées.
Conclusion : l’avenir des tours solaires dans la transition énergétique
Les déserts et montagnes deviennent des réservoirs d’énergie renouvelable grâce aux technologies modernes. Ces infrastructures offrent une production continue avec une maintenance réduite, idéale pour les zones isolées. Leur hybridation avec l’agriculture ou le dessalement multiplie les bénéfices.
Les défis persistent : coûts initiaux et acceptation sociale. Mais les innovations comme le projet Sumatel (tourbillons atmosphériques) pourraient révolutionner le secteur. Ces systèmes captent l’air chaud sur 20 km, augmentant la puissance.
À l’échelle du monde, ces solutions complètent les mix énergétiques. Les gouvernements et entreprises doivent investir pour accélérer leur déploiement. L’énergie renouvelable de demain se construit aujourd’hui.